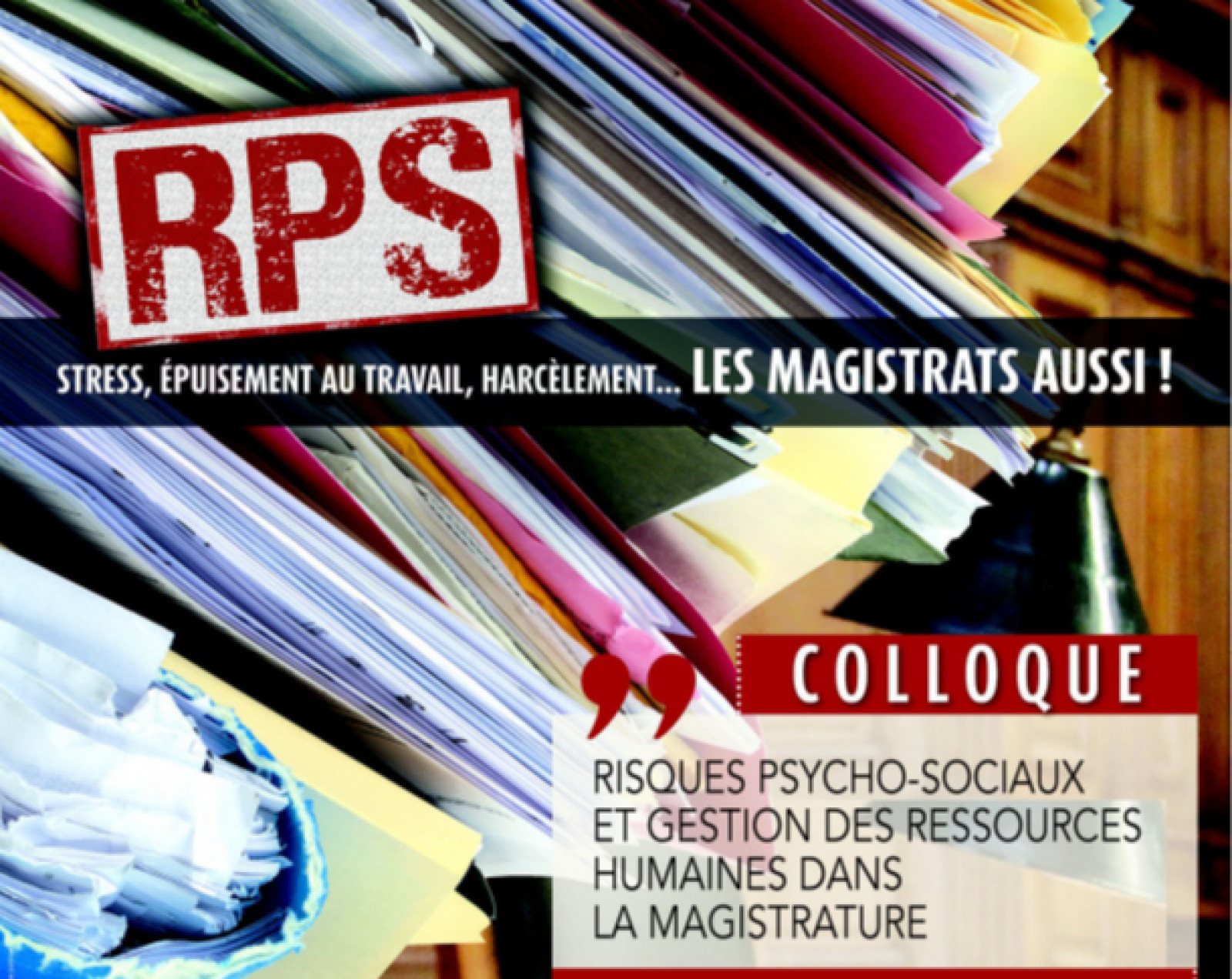Le Syndicat national des magistrats-FO entendu par la commission des lois de l’Assemblée nationale
Flash info 25/03/2015

Le Syndicat national des magistrats-FO entend faire valoir dans la présente note les observations qu’appelle de sa part l’examen du projet de loi relatif au renseignement, dans la seule perspective des rapports de la future loi avec les missions et le fonctionnement de l’institution judiciaire. Ceci le conduit toutefois à examiner le projet dans son ensemble, dans la mesure où il fait apparaître en contrepoint la nécessité de refonder globalement les dispositifs publics chargés d’assurer la sécurité collective.
On pourrait penser intuitivement que le fonctionnement des services de renseignement est sans rapport avec celui de la justice, mais ce serait négliger deux choses. Tout d’abord, il est nécessaire de disposer de critères appropriés pour définir le périmètre de la prévention d’un côté, celui de la répression de l’autre. Si la première (la prévention) relève notamment de la fonction « renseignement », en revanche la seconde (la répression) lui échappe, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006. Traditionnellement, la réciproque était aussi vraie : la justice (et la police judiciaire) n’avaient pas pour compétence ni préoccupation la prévention des menaces, celle-ci relevant des domaines de la police administrative et du renseignement.
Toutefois, et c’est le sens de la seconde observation liminaire, l’évolution du monde contemporain est telle que les nouvelles menaces qui sont apparues dans le sillage de la mondialisation bousculent la répartition des compétences entre les instances régaliennes. En effet, les problèmes de sécurité – dont la justice a le monopole de traitement sur le versant « répression » – ne se posent plus de la même manière dans un monde et dans une époque qui ne ressemblent plus en rien à ceux dans lesquels ont été conçues il y a deux cents ans les structures, les méthodes et les missions de l’institution judiciaire. Les phénomènes criminels les plus graves, quelles que soient leurs formes et leurs objectifs, sont devenus collectifs, organisés, ils se diffusent en réseaux et s’incrustent dans toutes les activités, légales ou non. La répression de ces nouvelles menaces n’a donc plus rien à voir avec la conception qui pouvait prévaloir quand la délinquance pouvait être perçue selon la règle des trois unités de la tragédie classique : unités de temps, de lieu et d’action…Il convient par conséquent d’examiner le projet au regard des réaménagements rendus nécessaires par l’émergence d’un monde totalement ouvert, qui produit des menaces posant elles-mêmes de nouveaux défis.
UN DISPOSITIF ATTENDU ET GLOBALEMENT SATISFAISANT, QUI PRÉCISE ET FIXE INDIRECTEMENT DANS LA LOI LA DOCTRINE FRANÇAISE DU RENSEIGNEMENT
Des inquiétudes qui paraissent injustifiées et traduisent une mauvaise compréhension de la doctrine de renseignement et du dispositif du projet de loi
Le projet de loi est l’objet d’inquiétudes ou de critiques tendant à le présenter comme un « USA Patriot Act à la française » destiné à donner aux services de renseignement des pouvoirs démesurés et faiblement encadrés. Il vise en réalité exclusivement à fournir, à une communauté du renseignement élargie, les moyens juridiques d’utiliser les nouvelles technologies indispensables à la sécurité nationale. Il n’est rien d’autre par conséquent qu’une mise à niveau du système français de renseignement aux standards des pays européens en termes de libertés et de droits de l’homme, face à un monde qui a par ailleurs profondément changé.
A cet égard, il faut apprécier la pertinence des choix effectués qui, contrairement encore à ce qui est présenté ici ou là, entérinent une priorité donnée au renseignement humain (HUMINT) sur le renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) et numérique, sans pour autant négliger les moyens technologiques les plus avancés dont doivent impérativement disposer les services de renseignement. Il serait inconcevable que ces derniers soient les seuls à ne pas pouvoir circuler dans le monde numérisé. Le projet de loi ne contribue pas pour autant à placer les NTIC sous leur dépendance. Le contrôle effectif des techniques intrusives, qui seront autorisées dans des conditions limitées et strictement déterminées, permet un recours maîtrisé aux technologies les plus récentes liées elles-mêmes à la diffusion massive des NTIC dans la vie quotidienne.
Le projet de loi dessine ainsi « en creux » une doctrine qui fait des moyens technologiques en question des subsidiaires par rapport aux méthodes traditionnelles. De ce fait, le risque de voir se développer des dérives similaires à celles du renseignement américain, dont les révélations ont légitimement fait scandale (Wikileaks, Snowden), est précisément écarté, à moins de dérives d’une gravité telle qu’elles remettraient en cause tout le fonctionnement de l’Etat. On peut considérer au contraire que le dispositif mis en place pérennise une conception qualitative du renseignement qui est l’inverse de celle qu’ont mise en place les Etats-Unis (qualifiée significativement de « pêche au chalut ») et, plus généralement, les pays anglo- saxons (avec bien entendu, des nuances concernant les autres pays, mais ceux-ci étant néanmoins associés à l’usage des technologies électromagnétiques et numériques utilisées massivement par les Etats-Unis depuis le réseau Echelon).
Un projet qui prend en compte les changements intervenus dans le monde et la réalité polymorphe des nouvelles menaces
Un autre aspect positif du projet de loi est de montrer que les services de renseignement ont (ou veulent se donner) la capacité de traiter l’information numérique et plus généralement les NTIC, dans un environnement très largement mondialisé.
Les nouvelles menaces – pour la plupart nées de la mondialisation ou ayant pris une dimension globale du fait de cette dernière –, s’organisent en réseaux, en subvertissant toutes les frontières : géographiques bien sûr, mais aussi économiques, financières, sociales, technologiques, industrielles, commerciales, criminelles, etc. Ces nouvelles menaces sont polymorphes, elles sont à la fois globales et locales, et elles se diffusent en utilisant tous les flux, les circuits et les réseaux de la mondialisation, licites et illicites, transparents ou occultes.
Cette mondialisation est d’abord technologique, puisqu’elle repose essentiellement sur la massification des moyens et des technologies d’échange et de circulation de l’ensemble des flux (informations, capitaux, connaissances, populations, marchandises et services licites ou illicites, etc.). Elle requiert par conséquent une doctrine de sécurité adaptée à un monde qui n’a plus rien à voir avec celui qui a pris fin lors de la chute du Rideau de fer.
Elle se caractérise de plus en plus aujourd’hui par l’émergence du « Big data », lequel n’est pas, contrairement à ce que laisseraient croire certaines analyses superficielles, entre les mains des Etats, mais entre celles de puissantes entreprises multinationales de (ou liées à) l’industrie numérique – Google, Facebook, Amazon, opérateurs téléphoniques, etc. – et de multitudes de start-up qui leur sont souvent liées. Les unes et les autres sont capables de développer dans le secret des méthodes et des moyens de traçage et d’analyse des comportements auxquels les Etats eux-mêmes, en dehors de celui des Etats-Unis, n’ont pas directement accès et qu’ils ne contrôlent pas ou ne peuvent maîtriser (à l’exception de pays comme la Chine ou la Corée du Nord).
A l’encontre de ce que certains semblent craindre, le danger pour les libertés publiques et privées vient donc plus de cette concentration du pouvoir d’information dans des espaces numériques qui échapperaient aux Etats et que ceux-ci ne pourraient plus réguler, que dans les exigences posées notamment dans le projet de loi à ces compagnies pour qu’elles entrouvrent leurs algorithmes et permettent aux services de renseignement d’y rechercher des informations essentielles pour l’accomplissement de leurs missions de sécurité publique. Le projet de loi relatif au renseignement est loin – et ce n’est pas son objet – de permettre une prise de contrôle de cette industrie numérique et plus encore de créer un « Big Brother » étatique. Il est tout au plus destiné à donner aux services de sécurité des accès ponctuels à certaines de ses ressources pour lutter contre des menaces identifiées mettant en danger des intérêts supérieurs.
Il n’y a pas matière par conséquent à le critiquer ni même à s’en inquiéter, dans la mesure où il vise précisément à fixer des règles d’emploi limité prenant en compte les principes dégagés par les grands principes européens des droits de l’homme.
UN DISPOSITIF EN DEUX PARTIES, QUI LIE LES TECHNIQUES DU RENSEIGNEMENT À SES DIFFÉRENTES FINALITÉS, EN RÈGLEMENTANT ESSENTIELLEMENT SES ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Une définition du périmètre d’action des services de renseignement à questionner.
Le nouvel article L. 811-3 du CSI définit les finalités du renseignement pour lesquelles l’usage des techniques intrusives est autorisé par la loi et, ce faisant, il dessine implicitement le périmètre effectif de compétence des services de renseignement.
Seuls les « intérêts publics » définis aux § 4, 5, 6 et 7 de cet article sont réellement susceptibles de concerner l’institution judiciaire en raison de leurs implications pénales, à savoir :
« 4° La prévention du terrorisme ; « 5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous (…) ; « 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; « 7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ».
Les autres domaines (§ 1 à 3) ne sont, pour cette dernière, qu’anecdotiques et ne requièrent pas en tout cas de sa part la mise en œuvre d’actions particulières susceptibles de créer des interférences entre la fonction prévention et la fonction répression. Le Syndicat national des magistrats-FO ne soutiendra donc pas les demandes qui pourraient tendre à placer le recours aux techniques intrusives, dans ces domaines, sous le contrôle du juge judiciaire, dans la mesure où celui-ci n’a aucune compétence ni légitimité pour y intervenir.
S’agissant des champs de compétence définis aux § 4, 5 et 7, le Syndicat national des magistrats-FO n’a pas non plus d’observation particulière à formuler sur leur intégration dans les finalités des services de renseignement au titre de la prévention.
Toutefois, le problème qui est posé dans ces domaines, et plus encore dans celui de la lutte contre la criminalité organisée (§ 6), est la définition du périmètre de la prévention par rapport à celui de la répression, dans la mesure où le destinataire final des renseignements recueillis ne peut y être légitimement que l’institution judiciaire.
Deux questions sont donc posées :
- Est-il judicieux que des enquêtes soient entamées en « renseignement administratif » alors que les informations recueillies ne pourront être légalement utilisées dans le cadre judiciaire ?
- Est-il judicieux de maintenir l’institution judiciaire à l’écart des évolutions qui, dans un nombre croissant d’autres pays, intègrent le « renseignement criminel » dans les méthodes policières de « droit commun » ?
Avant de répondre, il faut introduire une distinction entre les différents domaines, selon la manière dont se pose la question de la frontière entre prévention et répression.
Ainsi, la lutte contre le terrorisme a, dans la plupart des cas aujourd’hui, des implications autant internationales que nationales puisque les réseaux ont généralement des affiliations et des connexions transfrontières qui justifient une coopération entre services de renseignement des pays concernés et une action (officielle ou clandestine) de nos services à l’étranger. Les services français de renseignement peuvent, par exemple, détecter un réseau « dormant » en France (ou dont l’activité terroriste s’exerce exclusivement sur le territoire de pays étrangers), sur lequel il importe d’entretenir une surveillance – en relation le cas échéant avec les services étrangers concernés –, sans que la justice française ne puisse disposer de preuves suffisantes pour les juger (ou n’ait intérêt à le faire). Il en sera de même s’agissant de la surveillance des groupements dissous ou des groupes, plus ou moins informels, mettant en œuvre des actions violentes collectives (Black Blocks, éco-terroristes, hooligans, etc.). Il y a donc naturellement place, dans ces domaines, à une action en termes de prévention.
En revanche, dans le domaine de la criminalité organisée, quel que soit son niveau, la notion-même de prévention ne fait pas sens, puisque la détection d’un réseau délinquant ou criminel ne peut se faire que s’il existe déjà des éléments établissant l’existence d’activités illicites. De surcroît, le droit pénal français, qui incrimine l’ « association de malfaiteurs » et les infractions commises « en bande organisée », donne compétence au juge en amont de la réalisation effective d’infractions portant sur l’objet de ces associations ou de ces bandes, dès le moment de leur constitution. L’enquête judiciaire – au titre de la répression – peut donc intervenir dès la détection des agissements concernés, de telle sorte qu’on ne distingue pas en quoi il pourrait exister un domaine qui serait réservé à la « prévention » de la criminalité et de la délinquance organisées et distinct de la répression, si ce n’est sur l’exploitation de sources ouvertes ou l’utilisation de méthodes d’analyse du renseignement ne nécessitant aucune investigation intrusive.
Parmi les champs de compétence des services de renseignement tels qu’ils résultent de l’article L. 811-3, on peut établir par conséquent la typologie suivante :
- les intérêts publics relevant des seuls services de renseignement (§ 1 à 3),
- les intérêts publics relevant d’une compétence partagée avec la justice (§ 4, 5 et 7),
- les intérêts publics relevant de la seule compétence de l’institution judiciaire (§ 6).
Les questions suivantes qui se posent sont donc de savoir :
- s’il est pertinent de maintenir néanmoins la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées dans le périmètre d’une compétence purement administrative, elle- même entièrement concurrente de la compétence judiciaire (article L. 811-3 § 6 du CSI),
- comment régler le passage de l’administratif au judiciaire en cas de compétence partagée (article L. 811-3 § 4, 5 et 7 du CSI).
Les enjeux concrets de la répartition des compétences et les choix pratiques à opérer
S’agissant en premier lieu de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, la logique et l’application stricte des principes voudraient que toute action de renseignement soit intégrée dans le champ judiciaire, la prévention se confondant ici entièrement avec la répression.
Le choix inverse d’opérer en l’espèce une distinction manifestement artificielle entre prévention et répression peut s’expliquer par deux considérations : soit la méfiance traditionnelle des pouvoirs publics envers l’institution judiciaire, soit un constat plus rationnel de la part de ceux-ci concluant à l’incapacité – structurelle ou conjoncturelle – du système judiciaire à assimiler les méthodes et les techniques du renseignement. La première hypothèse serait évidemment l’expression d’une faute majeure, révélatrice avant tout d’une immaturité politique pour le moins préoccupante. Nous préférons par conséquent penser que c’est la seconde qui inspire le projet, laquelle peut elle-même revêtir deux aspects différents.
Le premier consiste à considérer que l’institution judiciaire ne peut et ne doit être que « réactive », c’est-à-dire ne peut intervenir qu’après la commission des infractions et dans l’unique perspective de les sanctionner selon la loi. Si telle est, bien entendu, la fonction essentielle de la justice, rien n’interdit toutefois à cette dernière de s’inventer d’autres modes d’action, non plus réactifs, mais « proactifs », aux fins de détecter les activités illicites et non d’attendre qu’elles soient subrepticement révélées ou qu’elles aient eu le temps de s’accomplir.
Le modèle d’ « intelligence led policing » (ILP, littéralement : police guidée par le renseignement), adopté par un nombre croissant de pays pour faire face aux nouvelles menaces, est précisément destiné à permettre la prise en compte de la démarche « renseignement » dans les pratiques policières (et, pour la France, judiciaires). Le but assigné à la répression est alors de parvenir, en outre, à neutraliser des menaces avant qu’elles ne soient devenues systémiques. La tradition inquisitoire française plaçant la police judiciaire sous la direction permanente d’un magistrat (juge d’instruction ou parquet), l’adoption en France d’un modèle d’ILP revisité en vue de tenir compte de cette spécificité répondrait à l’argument tiré de ’inadéquation de la justice en matière de renseignement.
Mais il existe un second argument possible, plus propre à emporter la conviction : à supposer que le modèle d’ILP, adapté comme il conviendrait aux particularités du système inquisitoire français, dépasse l’opposition sommaire « prévention = renseignement/répression = justice » en intégrant la dimension du renseignement dans l’action judiciaire, l’appareil judiciaire français n’est pas apte (ou, plus charitablement, n’est pas prêt) à subir une telle mutation.
Il est vrai en effet que la doctrine qui prévaut dans la totalité des parquets et des tribunaux est aujourd’hui incompatible avec une approche en termes de renseignement. Elle consiste, depuis de nombreuses années, à faire reposer l’essentiel du fonctionnement de la chaîne pénale sur le principe de la « réponse pénale » systématique, couplée au traitement en temps réel des procédures (TTR) qui privilégie un traitement rapide (sinon expéditif) de contentieux de masse sur la base d’enquêtes policières ou d’informations judiciaires minimales, en vue d’appliquer aux personnes poursuivies un traitement « sur mesure », aux visées essentiellement « restauratrices ». Outre la contradiction dans laquelle se débat sans succès le système judiciaire pour concilier traitement sur mesure et contentieux de masse (qui l’oblige en particulier à investir l’essentiel des moyens judiciaires dans le « traitement » des délinquants dans des conditions d’une rationalité et d’une efficacité très discutables), il est sûr que ce dogme et les pratiques qu’il a suscitées sont antinomiques d’une démarche qualitative nécessitant une approche stratégique de la criminalité et de la délinquance, notamment pour atteindre leurs formes les plus graves. Et il paraît illusoire de vouloir introduire en l’état d’autres problématiques comme celle du renseignement dans le fonctionnement et les méthodes judiciaires, dans la mesure où le TTR et la réponse pénale systématique ont engorgé les parquets et les tribunaux et imprégné tous leurs modes de travail, voire déformé leur perception de la délinquance et de la criminalité.
Un tel argument peut être entendu car il est pertinent et qu’il correspond à la réalité. Mais il ne doit pas conduire à la conclusion selon laquelle le système judiciaire ne serait pas réformable ou qu’il n’aurait pas besoin d’être réformé, les services de renseignement pouvant alors se substituer avantageusement à lui pour détecter les phénomènes criminels dans un cadre « préventif » qui leur serait aménagé. Ce serait une faute majeure de laisser perdurer un système dont on s’accorde à dire qu’il n’est plus en mesure de faire face à ses missions et surtout aux menaces les plus graves, ne serait-ce que pour une seule raison : la réforme de l’institution judiciaire est en tout état de cause indispensable si l’on veut assurer l’efficacité de la lutte contre les nouvelles menaces.
En effet, selon l’adage bien connu, la résistance maximale d’une chaîne se mesure à celle de son maillon le plus faible. Pour prendre une autre métaphore, on ne fait rien pousser en arrosant le sable, quelle que soit la quantité d’eau déversée. A supposer même que les services de renseignement, dont ce n’est ni forcément la culture, ni assurément la priorité, assureraient un travail de détection exemplaire de la criminalité organisée, il n’en reste pas moins que la prise en charge ensuite par les parquets, les juges d’instruction, les juges des libertés et de la détention, les tribunaux (ou les cours d’assises) et jusqu’aux juges de l’application des peines, des informations recueillies et analysées par les services, ne sera pas intégrée dans une culture différente, comme on peut le constater tous les jours, de celle qui prévaut pour le traitement en temps réel des contentieux de masse. De ce fait, quel que soit le choix retenu, il imposera une profonde réforme de la justice pour qu’elle adopte une autre culture et une autre doctrine de lutte contre la délinquance et la criminalité. A défaut, toutes les actions de renseignement en amont, même les plus efficaces, viendraient arroser un terrain parfaitement stérile.
Ainsi, la réforme du renseignement fait ressurgir le besoin impératif et urgent d’une autre réforme, celle de la justice, maillon faible de la chaîne pénale prise dans toute sa longueur, qui va de la prévention à la répression.
Or il est certain que non seulement une telle réforme d’envergure n’est pas à l’ordre du jour, mais que le ministère de la justice, pas plus que l’institution judiciaire, ne sont mûrs aujourd’hui pour s’y engager. Nous reviendrons plus loin sur les préconisations du Syndicat national des magistrats-FO en cette matière, mais le réalisme conduit sans doute, en attendant, à se rallier temporairement à la solution proposée dans le projet de loi. Elle ne saurait toutefois valoir que comme un pis-aller provisoire et à condition d’être immédiatement accompagnée, pour le moins, d’incitations très fortes en direction des parquets afin qu’ils commencent à intégrer la culture du renseignement dans leurs pratiques professionnelles. Si l’on peut penser (ou espérer) que cette culture n’est pas étrangère au parquet de Paris spécialisé dans l’antiterrorisme, elle reste très vraisemblablement à être étendue dans l’ensemble des parquets des JIRS et de façon certaine dans ceux des autres ressorts. Il a été rapporté par exemple au Syndicat national des magistrats-FO que, dans tel grand tribunal d’Ile-de-France particulièrement affecté par le trafic de stupéfiants, le parquet avait pu refuser d’engager des investigations dans des affaires de cette nature, au simple motif qu’il avait été procédé préalablement à des interceptions de sécurité dans le cadre administratif… Il est à craindre qu’une telle méfiance et une telle incompréhension des enjeux et des responsabilités ne soient pas une attitude exceptionnelle au sein de la magistrature française. On ne saurait, bien évidemment, se contenter de le déplorer.
S’agissant ensuite des domaines de compétence partagée, le projet de loi est muet sur la manière d’articuler le passage de l’administratif au judiciaire. Dans sa décision du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel avait certes rappelé « l’obligation qui incombe à toute autorité administrative, lorsqu’elle acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser l’autorité judiciaire », après avoir réaffirmé le principe selon lequel les mesures de police administrative « ne sont pas placées sous la direction ou la surveillance de l’autorité judiciaire, mais relèvent de la seule responsabilité du pouvoir exécutif ; qu’elles ne peuvent donc avoir d’autre finalité que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ».Toutefois, l’article 40 du CPP ne comportant aucune sanction, cette disposition ne trouve que rarement application dans l’administration en général (et certainement pas en tout cas dans les affaires qui le mériteraient le plus) et il est fort improbable qu’elle soit perçue comme une obligation pour les services de renseignement en particulier. Quelques affaires concernant TRAFIN ont montré d’ailleurs que les services de renseignement pouvaient être sensibles à des considérations étrangères à leur mission, notamment quand sont mises en cause des personnalités connues.
L’obligation de dénonciation de l’article 40 ne règle donc en rien, dans la pratique, la question de la transmission effective d’un signalement au procureur de la République. La règlerait-elle en son principe, que toutes les difficultés n’en seraient pas résolues pour autant. La question de savoir à quel moment et sur quelle base factuelle le dossier doit être transmis de l’administratif au judiciaire resterait entière, chaque institution ayant par nature tendance à vouloir conserver sa saisine le plus longtemps possible, indépendamment de toute autre considération.
Par ailleurs, les logiques et les objectifs des services de renseignement n’étant pas les mêmes que ceux de la justice, il est loin d’être certain que les premiers n’aient pas, dans certains cas, la tentation de ne rien révéler au parquet, afin par exemple de pouvoir utiliser à des fins diverses les filières criminelles qu’ils ont identifiées ou infiltrées ou les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de stratégies qui seraient – à leurs yeux en tout cas – compromises par une dénonciation dans les formes prévues par le CPP. A l’inverse, tout étant possible, on peut imaginer d’autres situations, dans lesquelles par exemple le parquet accepterait que les services de renseignement continuent de traiter en administratif des affaires qui devraient relever du judiciaire en raison des éléments déjà recueillis (ne serait-ce, par exemple, que pour éviter d’avoir à ouvrir une information judiciaire).
Ainsi, malgré la clarté de la règle de séparation des pouvoirs et la répartition des compétences qui en découle, rien ne vient régler en pratique la délicate question de frontière entre l’administratif et le judiciaire. Il pourrait y être apporté une solution au moins partielle en introduisant un certain nombre de dispositions nouvelles dans la rédaction de l’article 40 du CPP : tout d’abord, en prévoyant que la déclaration obligatoire au procureur de la République est de la responsabilité du chef de service, manière de responsabiliser la hiérarchie au sein des services pour qu’ils veillent à la respecter. Ensuite en assortissant le non respect de l’article 40 du CPP d’une sanction pénale, dont il est probable qu’elle serait à elle seule dissuasive pour éviter tout « oubli » de transmission au parquet.
S’agissant du domaine de compétence exclusive de la justice (criminalité et délinquance organisées), le Syndicat national des magistrats-FO préconise une action en deux temps.
Pour les raisons indiquées plus haut, il paraît prématuré de priver dès à présent les services de renseignement de la possibilité de mener des investigations dans le cadre administratif, mais il est néanmoins urgent de conduire, sans plus attendre, une réflexion approfondie sur l’introduction du renseignement criminel dans les objectifs et les méthodes judiciaires. Cette question fait l’objet de réflexions et d’un début de mise en œuvre actuellement au sein des services de police et de gendarmerie, mais il convient de les élargir en direction de l’institution judiciaire elle-même, puisqu’elle est naturellement appelée à diriger et surveiller l’action des services de police judiciaire. Cela apparaît d’autant plus nécessaire que le décret prévu par l’article L. 811-4 du CSI devra préciser notamment quels sont les services autres que ceux désignés par l’article D. 1122-8-1 du code de la défense qui pourront recourir aux techniques intrusives prévues dans ce texte (ou à certaines d’entre elles), en fonction des finalités qu’ils auront à poursuivre. On voit mal comment ce texte réglementaire pourrait être pris sans avoir au préalable une vision claire de la configuration qui résultera de l’ajout de ce second cercle au noyau dur de la « communauté du renseignement » puisqu’il s’agit de services qui ont pour certains (gendarmerie, DRPP) des compétences judiciaires.
En résumé, il semble par conséquent que la meilleure solution soit, dans un premier temps, d’intégrer la « prévention » de la criminalité et de la délinquance organisées dans les finalités des services de renseignement pour lesquelles le recours aux techniques intrusives peut être autorisé, comme le prévoit le projet de loi. Toutefois, il importe de prolonger au plus vite, dans un second temps, le travail qui a été effectué pour clarifier le régime d’intervention des services de renseignement de manière à repenser l’organisation judiciaire et à la rendre en mesure de s’adapter aux exigences du renseignement criminel. Il est proposé pour ce faire les mesures suivantes :
- engager une réflexion d’ensemble sur les objectifs, les méthodes et les moyens de la chaîne pénale au service de la sécurité publique. On peut concevoir qu’elle soit menée soit dans le cadre de la rédaction d’un Livre blanc, soit au sein d’une mission d’information du Parlement ;
- limiter la durée de validité de la loi à trois ans afin que le Parlement puisse faire, à l’issue de ce délai, un bilan de son application qui conduira à harmoniser le dispositif du renseignement avec celui qui résultera de la réforme judiciaire.
AVIS DU SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS-FO SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU RENSEIGNEMENT
Avis d’ensemble
- Le projet de loi relatif au renseignement déposé par le gouvernement représente une démarche positive dans son ensemble ;
- Il ne saurait pour autant être considéré comme un aboutissement ;
- Il conviendrait par conséquent de l’améliorer par un certain nombre de dispositions complémentaires ;
- Il faudrait entreprendre dès à présent une vaste réflexion d’ensemble sur les autres aspects de la lutte contre les nouvelles menaces qui ne sont pas prises en compte dans ce texte ;
- Cette réflexion devrait avoir pour objectif d’adapter le système judiciaire aux nécessités du renseignement criminel
Préconisations
1. Dans un premier temps :
- Adopter telles quelles les finalités prévues par l’article L. 811-3 du CSI ;
- Modifier l’article 40 du CPP pour imputer aux chefs de service l’obligation de dénonciation au procureur de la République ;
- Introduire une sanction pénale en cas de non respect de l’article 40 du CPP ;
- Limiter la durée de validité de la loi relative au renseignement à trois ans ;
- Engager le gouvernement à présenter un bilan d’application de la loi à l’issue de ce délai ;
- Engager une vaste réflexion, dans le cadre d’un Livre blanc sur la sécurité intérieure et la chaîne pénale ou une mission d’information parlementaire, en vue d’adapter l’ensemble de la politique pénale aux nouveaux défis criminels ;
2. Dans un second temps :
- Présenter au Parlement une réforme en vue d’adapter l’organisation judiciaire aux missions de lutte contre les formes modernes de criminalité et de délinquance, en l’axant autour du renseignement criminel ;
- Pérenniser la loi relative au renseignement en retirant aux services de renseignement la finalité de la « prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » et y apporter toutes les améliorations rendues nécessaires au vu du bilan présenté par le gouvernement ;